
Common menu bar links
Institutional Links
-
Translation Bureau
Language Portal of Canada
-
TERMIUM Plus®
-
Titles
- Abrégé de traduction automatique
- Accord légitime
- Accroître son QC (quotient courriel)
- Adresses Web : Faut-il inclure « http:// » et « www »?
- Affaire Dame Action c. Sieur Recours. Cette action vaut-elle un recours?
- Aimez-vous la nouvelle orthographe?
- Ainsi que, de même que, comme, et les autres
- À la recherche du français perdu : la pertinence de Proust
- Améliorez la lisibilité visuelle grâce aux titres et sous-titres
- Après que et le subjonctif
- À propos de décade
- À propos d’« identifier »
- À travers le prisme de l’histoire : Complot acadien et traducteurs « frappés au cerveau »
- À travers le prisme de l’histoire : Erreurs de traduction historiques, fatidiques ou cocasses
- À travers le prisme de l’histoire : Jean L’Heureux : interprète, faux prêtre et Robin des bois
- À travers le prisme de l’histoire : John Tanner, un Indien blanc entre l’arbre et l’écorce (I)
- À travers le prisme de l’histoire : John Tanner, un Indien blanc entre l’arbre et l’écorce (II)
- À travers le prisme de l’histoire : Joseph de Maistre ou Alexandre Pouchkine? La confusion de Babel
- À travers le prisme de l’histoire : Le français, langue de travail dans l’Ouest
- À travers le prisme de l’histoire : Personnages colorés, privilèges et brillantes réparties
- À travers le prisme de l’histoire : Traduire dominion par « puissance » : était-ce une « absurde vanterie »?
- Aux verbes-signaux, arrêtez-vous!
- Baudelaire traduit en prison par un professeur de traduction
- Bien que : indicatif ou subjonctif?
- Bijuridisme canadien : questions d’harmonisation
- Bottleneck : Goulot ou goulet d’étranglement?
- Bousculade de que
- « capable » et « susceptible »
- Carbure ou carbone?
- CE livre ou LE livre
- Ce n’est pas dans le dictionnaire. Ce n’est donc pas… bon! ou la quête de la bonne préposition dans les ouvrages de référence
- Centre ou Palais des congrès?
- Cet accommodement est-il raisonnable?
- Changer de supermarché, vraiment?
- Cinquante ans d’interprétation parlementaire
- Classifier (to classify) ou classer (to classify)
- Clearance : un terme polysémique
- Combien faut-il être pour être plusieurs?
- « Comme il l’a été mentionné » : un intrigant pronom personnel
- Comment courir un risque
- Comment le français et d’autres langues ont façonné l’anglais
- Comment se faire octroyer une subvention
- Comment traduire l’expression safe and secure?
- Comment traduire lie quand on joue au golf
- Comme quoi l’ivraie de l’un peut être le bon grain de l’autre
- Communication claire et efficace : faciliter la lecture
- Communication claire et efficace : favoriser la rétention de l’information
- Communication claire et efficace : réduire le niveau d’inférence
- Comprendre les moteurs de recherche
- Concept : concept, idée, notion
- Conflit d’horaire, conflit de vocabulaire
- Dans le cybermonde des newbies
- De la graphie d’« attentat suicide »
- De la graphie du mot professionnèle
- De la vérification à l’audit
- Dépasser le mot image : une obligation pour le traducteur
- Des auxiliaires will et shall
- Désigner les espèces en péril au Canada
- Des mots pour parler des hybrides
- Des plans, des domaines, des ordres et autres curiosités
- Des services, une page Web… ça se partage?
- Deux locutions : à l’endroit de, avec comme objectif
- Development : Développement?
(développement, épanouissement, perfectionnement, aménagement ou géonomie?) - Directeur ou gérant
- Disability : déficience, incapacité, handicap…
- Documents échangés entre acheteur et vendeur : Appel d’offre = Inquiry?
- Don et ses dérivés
- Donnez généreusement, mais n’échangez pas
- Dont : un pronom capricieux
- Du bon emploi de « chez »
- Du métier dans le corps, de la passion dans l’âme
- Du noble mal tourné?
- Du secteur privé au secteur public : quelques exemples de néologismes de sens
- Du sexe de l’Act
- Écriture des numéros de téléphone : la parenthèse tombe
- Émergence d’une nouvelle terminologie bijuridique dans les lois fédérales
- Emplois abusifs d’avec
- En avoir ou pas
- Enfin, ils en sont arrivés à une entente
- « Enjoindre »
- Est-elle membre fondateur ou membre fondatrice?
- Était-ce le docteur Jekyll ou M. Hyde?
- Et ce : est-ce bien cela?
- Êtes-vous autantiste?
- Être à l’emploi de
- … Et vogue L’Actualité
- Executive summary
- Faire face à
- Fédéral-provincial ou fédéro-provincial?
- Fiche de famille : suggestion
- Genres et sexes en français
- Gens d’ici et gens d’ailleurs : comment les nommer
- Gestion de la qualité, contrôle de la qualité ou assurance de la qualité?
- Grammaire traditionnelle et grammaire nouvelle : la mère et la fille
- Grammaire traditionnelle ou nouvelle grammaire? Une fausse question, un vrai débat
- Grandeur et misère du participe présent
- Grandeurs et misères de la traduction collaborative en ligne
- Guidelines : lignes directrices
- Halifax en passant par Hull
- Imbécile – Tu n’en connais pas l’étymologie? – Oui, mais…
- « Imposer une sentence »
- Inactifs, les chômeurs?
- Informal : Informel
- Initiation aux macros pour les langagiers
- « Internet » : un casse-tête pour les langagiers
- Interprétation des conférences : Petite équipe, grande mission
- Inuit, un mot qui ne fait plus exception
- Jurilinguiste, terminologue-juriste et terminologue juridique : un problème terminologique?
- « Jusqu’à tout récemment »?!
La règle et l’usage - La conjonction puisque, et un possessif ambigu
- La dérive anglicisante du français technique
- La dictée est-elle dépassée?
- L’adjectif qualificatif : article de grande consommation directrice
- La langue et l’oreille: Vous êtes dur d’oreille? Non, c’est dur pour l’oreille
- La langue et Pavlov
- L’aménagement jurilinguistique au Canada
- La néonymie grand public
- Langue claire et simple : évaluer l’utilisabilité des documents
- Langue claire et simple : rédiger des documents lisibles
- Langue claire et simple : rendre le message intelligible
- Langue claire et simple : surmonter les obstacles à la littératie
- Langues nationales et acquisition de connaissances spécialisées en traduction technique
- La normalisation en common law en français au Canada : Une étude de cas
- La petite histoire d’une expression : À la bonne franquette
- La petite histoire d’une expression : Avoir des yeux de lynx
- La petite histoire d’une expression : C’est une autre paire de manches
- La petite histoire d’une expression : Découvrir le pot aux roses
- La petite histoire d’une expression : Être laconique
- La petite histoire d’une expression : Être le dindon de la farce
- La petite histoire d’une expression : Faire ou ne pas faire long feu?
- La petite histoire d’une expression : Perdre son latin
- La petite histoire d’une expression : Rester bouche bée
- La petite histoire d’une expression : Se faire l’avocat du diable
- La petite histoire d’une expression : Tenir le haut du pavé
- La petite histoire d’une expression : Un vent à (d)écorner les bœufs
- La « postposition »
- La reconnaissance vocale et les langagiers
- La règle de la supériorité
- La renaissance d’une langue
- La sécurité de vos données, ça vous intéresse?
- La simplicité volontaire en traduction
- La terminologie de la nouvelle grammaire
- La terminologie des gangs de rue sous la loupe
- L’athlétisme, discipline reine des Jeux
- L’aube du troisième millénaire, déjà?
- La vérification de l’exactitude technique de la traduction
- Le COSLA, une occasion rêvée de simplifier le langage administratif
- Le courriel : bénédiction et malédiction
- « Le courrier des lecteurs » : Ce n’est pas le moment de biaiser!
- « Le deuxième plus important »
- Le français victime du hit?
- Le genre des sigles
- Le jour et la nuit
- Le legs de McLuhan
- Le mot PATTERN et sa myriade d’équivalents
- L’endogénisme linguistique au Québec
- Le point sur la nouvelle orthographe
- L’équivalent français de common law
- Les 8 et 9 novembre « prochain » ou « prochains »?
- Les anglicismes insidieux
- Les années quatre-vingt ou quatre-vingts?
- Les avatars d’un mot
- Les caprices de l’usage : le cas de prévu
- Les centres de jurilinguistique au Canada
- Les changements climatiques, un problème singulier
- Le sens d’amender s’est-il modifié?
- Le Service SVP, d’hier à aujourd’hui
- Les fonctionnalités des mémoires de traduction
- Les injures racistes ont-elles leur place dans les dictionnaires?
- Les jeux de caractères et leurs mystères…
- Le slavon liturgique, ça se lit comme un roman… ou presque!
- Le sous-titrage vocal
- Les outils d’analyse de la nouvelle grammaire : dessine-moi une phrase
- L’espace insécable
- Les papillons pris aux filets de la langue
- Les problèmes posés par l’emploi de l’épithète
- Les subtilités de la politesse
- Les traducteurs et la recherche terminologique ponctuelle au 21e siècle
- Les « ventres à louer »
- Lettre ouverte aux jeunes langagiers
- Le verbe à tout faire
- Le verbe focaliser et les compléments de temps
- L’évolution de la méthodologie : un périple dans le temps
- Lexique panafricain de la femme et du développement
- « L’heure est grave », a analysé le ministre.
Quelques réflexions sur les incises - L’homme et la machine, duo productif… et positif?
- Lié/relié et la cohérence dans les énumérations
- L’indexation de la piastre
- L’informatique dans les nuages
- L’innovation et la norme dans les pratiques de rédaction non sexistes
- L’innovation et la norme dans les pratiques de rédaction non sexistes (2e partie)
- L’Institut d’été de jurilinguistique prend de l’ampleur
- L’inversion dans l’incise
- « LITERACY » et « INFORMATION LITERACY »
- L’obligation sans « devoir »
- Lumières sur un laissé-pour-compte : le terme hakapik
- L’utilisation des corpus en traduction
- Lutte à vs lutte contre
- Madame la sénatrice?
- Maison à vendre, oui mais par qui?
- Manual : Manuel ou Guide
- Ma quête d’information en 2010
- Mémoires de traduction et traduction automatique
- Memorandum : Mémorandum? Note?
- Mil aurait-il franchi ses derniers milles?
- Mondialisation : les langagiers oubliés
- Mon rapport au dictionnaire (partie 1)
- Mon rapport au dictionnaire (partie 2)
- Mots de tête : « ajouter l’insulte à l’injure »
- Mots de tête : « à l’année longue »
- Mots de tête : « à l’effet que »
- Mots de tête : « à même »
- Mots de tête : « anxieux de » + infinitif
- Mots de tête : « à ou ou? »
- Mots de tête : Arguez, arguez, il en restera peut-être quelque chose
- Mots de tête : « à toutes fins pratiques »
- Mots de tête : « à travers le monde » et « dans tout le pays »
- Mots de tête : « aux petites heures »
- Mots de tête : « avant-midi »
- Mots de tête : Avez-vous de la tchatche?
- Mots de tête : « avoir le dos large »
- Mots de tête : « ça augure bien mal »
- Mots de tête : « comme étant »
- Mots de tête : « dans le même bateau »
- Mots de tête : Deux mal aimés
- Mots de tête : De vigne en branche
- Mots de tête : Dévoiler à tout vent
- Mots de tête : « différend sur la différence »
- Mots de tête : « du même souffle »
- Mots de tête : « élaboré »
- Mots de tête : « en autant de »
- Mots de tête : « en autant que »
- Mots de tête : « en bout de » à toutes les sauces
- Mots de tête : « en charge de »
- Mots de tête : « en d’autres mots »
- Mots de tête : Endosser, un verbe qui se porte bien
- Mots de tête : « enjeux »
- Mots de tête : « en plus de » + infinitif
- Mots de tête : « en rapport avec »
- Mots de tête : « en rapport avec » (prise 2)
- Mots de tête : « en termes de »
- Mots de tête : « en tout et partout »
- Mots de tête : Entre taille et grandeur
- Mots de tête : « être à son meilleur »
- Mots de tête : « être familier avec »
- Mots de tête : « être (ou ne pas être) sorti du bois »
- Mots de tête : « faire (du) sens »
- Mots de tête : « faire sa marque »
- Mots de tête : « faire sa part »
- Mots de tête : « hors de question »
- Mots de tête : « il me fait plaisir »
- Mots de tête : « impliqué »
- Mots de tête : « incidemment »
- Mots de tête : « intéressé à » + infinitif
- Mots de tête : « jeter l’enfant avec l’eau du bain »
- Mots de tête : L’art de se tirer (une balle) dans le pied
- Mots de tête : Le nez qui voque
- Mots de tête : L’inclusion pour tous
- Mots de tête : « livrer la marchandise »
- Mots de tête : « loose cannon »
- Mots de tête : L’opportunité fait-elle le larron?
- Mots de tête : « Marcher des milles ou faire des kilomètres à pied? »
- Mots de tête : « mordre la main qui nourrit »
- Mots de tête : « non seulement ou de l’inversion du sujet »
- Mots de tête : « par le biais de »
- Mots de tête : « partisan(n)erie »
- Mots de tête : « paver la voie »
- Mots de tête : Peut-on manger dans la main de quelqu’un avec une cuiller d’argent dans la bouche?
- Mots de tête : « plus souvent qu’autrement »
- Mots de tête : « premier » et « dernier »
- Mots de tête : « prendre avec un grain de sel »
- Mots de tête : « revers de la main »
- Mots de tête : « (se) traîner les pieds »
- Mots de tête : « siéger à, dans ou sur? »
- Mots de têtes : « mon nom est »
- Mots de tête : « sous l’impression que »
- Mots de tête : « supposé » + infinitif
- Mots de tête : « supposément »
- Mots de tête : « tel que » + participe passé
- Mots de tête : « tentative de » + infinitif
- Mots de tête : « tournant du siècle »
- Mots de tête : « tous et chacun »
- Mots de tête : Traduire « eventually » par « à terme »? Éventuellement…
- Mots de tête : Trente ans après
- Mots de tête : Un adverbe qui se fait rare
- Mots de tête : Un « barbare » au Palais-Bourbon
- Mots de tête : « une table à mettre »
- Mots de tête : Un événement qui tourne à la manifestation
- Mots de tête : Un imposteur dans la maison
- Mots de tête : Un mot qui sème la division
- Mots de tête : Un profil à deux faces
- Mots de tête : « Un tapis rouge qui vire au bleu »
- Mots de tête : Un visa pour « émettre »
- Mots de tête : « vocal »
- Mots de tête : « vœu pieux »
- Mots de tête : Vous avez dit animisme?
- Mots de tête : « voyage en étrange pays, où la lune boit, les vaches mentent et les renards font l’café »
- Mots de tête : « you can’t have your cake and eat it too »
- Ne jetez pas l’éponge!
- Ne vous laissez pas embarquer!
- N’importe quel ou lequel?
- Non seulement n’a-t-il pas raison, mais encore il a tort!
- Non seulement ou le sujet attrapé par la queue
- Nos voisins les « États-Uniens »
- Nouvelle orthographe : un sujet bien d’actualité
- œuvre monumentale (…)
- Officers et Officials
- Ombudsmans? Ombudsmen? Le pluriel des mots d’origine étrangère
- Organisation ou organisme?
- Où il sera question de veille et d’intelligence
- Pas d’accent sur les sigles
- Pensez-y bien avant de partager vos opinions
- Petit cours sur le verbe confirmer
- Petite histoire du terme « sida »
- Petite montée de lait
- Petit lexique d’expressions composées avec clearance
- Pièges à éviter à la radio… et à la télé
- Pléonasme littéraire et pléonasme vicieux
- Plus de ou plus que
- Plus important,…
- Policy et policies
- Ponctuation, trait d’union et temps de verbe
- « Pour atteindre »
- Pour des conversations par Internet réussies
- Pour Mémoire
- Pour traduire Twitter
- Précisions et distinctions, 1
- Précisions et distinctions, 2
- Prendre pour acquis
- Préséance & ligatures
- Prévoir et précéder
- « Proactif » dans le vocabulaire de la gestion
- Problèmes de syntaxe
- Project : Projet?
- Puis, les années ont passé…
- Quand on ignore impunément une mesure drastique
- Quarante ans d’évolution en un clin d’oeil
- Quelques remarques sur la concordance des temps
- Qu’est-ce qu’un wiki?
- Question de typographie
- Quitter dans l’absolu
- Reculer d’abord ou sauter tout de suite?
- Réformer sans défigurer
- Regard sur la terminologie adaptée à l’interprétation
- Réhabilitons nos chevreuils
- Renseigner un champ, carter un ado
- Responsable, mais de quoi?
- Retention : un problème complexe pour le traducteur et le terminologue
- Retour sur le mot globalisation
- Retour sur tel que
- Rêves réalistes d’un langagier
- Risques à prendre ou à courir
- Royalties
- « S’assurer que »
- S’avérer vrai, s’avérer faux?
- Secrets bien gardés des mémoires de traduction
- Se porter candidat – candidate
- Shale gas : gaz de schiste ou gaz de shale?
- Shy, lazy … in other words: real nice!
- Simple ou double?
Re(s)soulever la question, c’est re(s)semer le doute - Si vous êtes d’accord…
- Soit… soit…
- Stupéfait et stupéfié
- Sûreté et Sécurité
- Sur ponterelle ou au mouillage?
- Survie ou survivance
- Taxinomie ou taxonomie? Quand l’usage s’emmêle
- Tendances
Les logiciels libres (et souvent gratuits) du domaine public - Tendances
Le supplice a assez duré
(Libérez les données prises en otage!) - Terminologie autochtone : une terminologie en évolution qui se rapporte aux peuples autochtones au Canada
- Timeo hominem unius libri
- Titres des lois et règlements : quelques règles
- To account for – Is accounted for by
- To affect
- To demonstrate : démontrer ou montrer?
- Traduction et tauromachie
- Traduire dans le domaine de la sécurité, c’est dur, dur, dur!
- Traduire le monde
- Traduire le monde : 30 ans de nouveaux noms de pays
- Traduire le monde : Amender la constitution?
- Traduire le monde : Atlas et graphies savantes
- Traduire le monde : Changer le monde
- Traduire le monde : Chercher dans Internet?
- Traduire le monde : Chinoiseries occidentales
- Traduire le monde : Commonwealth ou Communauté?
- Traduire le monde : Congolais, dites-vous?
- Traduire le monde : De l’Afrique
- Traduire le monde : De l’Allemagne
- Traduire le monde : Des noms! Des noms!
- Traduire le monde : Deux pays, deux systèmes politiques
- Traduire le monde : Élision, omission et toponymes
- Traduire le monde : États-Uniens ou Américains?
- Traduire le monde : Êtes-vous international?
- Traduire le monde : Gentilés et genre grammatical : des dictionnaires toujours aussi imprécis
- Traduire le monde : Grande-Bretagne ou Royaume-Uni?
- Traduire le monde : Juifs, Hébreux, Israélites… et Sémites
- Traduire le monde : La dérive des continents
- Traduire le monde : la Syrie ou la République arabe syrienne?
- Traduire le monde : Le développement démocratique?
- Traduire le monde : Le monde islamique
- Traduire le monde : Le néerlandais pour tous
- Traduire le monde : Le plat pays du flamand traduit
- Traduire le monde : Le pluriel de taliban
- Traduire le monde : les adresses à l’étranger
- Traduire le monde : Les Bagdadis?
- Traduire le monde : Les États américains revisités
- Traduire le monde : Les États-Uniques
- Traduire le monde : Les fourches caudines et autres expressions historiques
- Traduire le monde : Les gentilés et toponymes composés
- Traduire le monde : Les majuscules dans les noms de pays
- Traduire le monde : Les Nations Unies
- Traduire le monde : Les noms américains : traduire ou pas?
- Traduire le monde : les noms de capitales
- Traduire le monde : les noms de guerres et de révolutions
- Traduire le monde : les noms de ministères
- Traduire le monde : Les noms d’universités
- Traduire le monde : Les parlements
- Traduire le monde : Les partis politiques et leurs membres
- Traduire le monde : Les sigles en relations internationales
- Traduire le monde : les unités monétaires
- Traduire le monde : Le Timor-Oriental et autres pays
- Traduire le monde : Le vocabulaire politique britannique
- Traduire le monde : L’île mystérieuse
- Traduire le monde : L’Iraq ou l’Irak?
- Traduire le monde : L’Utopie, ou ces pays qui n’existent pas
- Traduire le monde : Macédoine, Monténégro et République tchèque
- Traduire le monde : Malaisie ou Malaysia?
- Traduire le monde : Mers et monde
- Traduire le monde : Mumbai ou Bombay?
- Traduire le monde : Mythes et toponymes
- Traduire le monde : Places publiques et monuments étrangers
- Traduire le monde : Poutine en français et Putin en anglais. Pourquoi?
- Traduire le monde : Que faire avec les noms d’organismes étrangers?
- Traduire le monde : Scandinavie, pays nordiques ou Europe du Nord?
- Traduire le monde : Splendeurs et misères de la typographie
- Traduire le monde : Sud-Soudan ou Soudan du Sud?
- Traduire le monde : Toponymes disparus
- Traduire le monde : Traduire les noms propres?
- Traduire le monde : Turqueries
- Traduire le monde : Venise du Nord et autres surnoms
- Traduire pour l’aviation civile et militaire
- Traduire should
- Twitter fait gazouiller!
- Une femme-orchestre et un homme au foyer : l’innovation et la norme dans les expressions non sexistes
- Une sœur d’arme et un père poule : l’innovation et la norme dans les expressions non sexistes (2e partie)
- Une traductrice médicale à la finale masculine de Wimbledon ou le problème de l’hypallage
- Un hommage gaspéen ou gaspésien?
- Un hommage gaspéen ou gaspésien? …la suite
- Un interdit affecté par l’usage
- Un lexique parlementaire trilingue
- Un mot pittoresque et perfide : Challenge
- Voisinage et collisions
- Voyage singulier des Escoumins aux Saintes-Maries-de-la-Mer
- WeBiText à la rescousse
- « Webmaster »
- Whichever is the later, the earlier, the lower, etc.
- Without prejudice
Proactive Disclosure
Important notice
This version of Chroniques de langue has been archived and won't be updated before it is permanently deleted.
Please consult the revamped version of Chroniques de langue for the most up-to-date content, and don't forget to update your bookmarks!
Search and Functionalities Area
À travers le prisme de l’histoire : Personnages colorés, privilèges et brillantes réparties
Les traducteurs fédéraux, 1867-1967 (I)
« Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres. »
Alexis de Tocqueville
Depuis la Confédération, les premiers traducteurs ayant exercé leur métier sur la colline du Parlement et dans les divers ministères de la Capitale ont acquis, au fil des ans, la réputation de spécialistes de la langue et de la traduction. À une époque où les ouvrages de référence sont encore rares et les aides informatiques à la traduction inexistantes, ils ont posé les premières pierres de la renommée dont jouit aujourd’hui le Bureau de la traduction. La réputation de ce centre d’excellence, à qui l’on a confié la gestion du Portail linguistique du Canada, déborde nos frontières, grâce, entre autres, au rayonnement international de TERMIUM Plus®, sa banque de terminologie.
Dans une série d’articles consacrée aux traducteurs fédéraux qui couvrira la période de 1867 à 1967, j’aimerais sortir de l’ombre ces premiers artisans de la traduction parlementaire et administrative. Cette rétrospective historique sera l’occasion d’évoquer les modalités d’embauche et les conditions de travail qui avaient cours à l’époque, et d’esquisser le portrait de quelques personnages colorés du premier siècle de traduction officielle à Ottawa.
Ces traducteurs aiment manier la plume – beaucoup sont écrivains, poètes ou journalistes – et animent la vie littéraire et culturelle dans la Capitale. Leur contribution à la vie professionnelle est importante également. On leur doit la création des deux premières associations de traducteurs : le Cercle des traducteurs des livres bleus (1919) et l’Association technologique de langue française d’Ottawa (1920), de même que la création des premiers cours de traduction. Ces regroupements ont fait naître dans leurs rangs un esprit de corps et conduit à leur reconnaissance par le reste de la fonction publique, les associations professionnelles et les syndicats, dont l’Institut professionnel de la fonction publique.
L’« âge d’or » de la traduction
Écrivain, lexicographe et homme de vaste érudition, Hector Carbonneau (1889-1962), qui fut à la tête du service de la Traduction générale1 pendant plus de trente ans, a qualifié la période antérieure à la centralisation des services de traduction (1867-1934) d’« âge d’or de la traduction2 ». Le qualificatif est bien choisi si l’on entend par cette expression une période où le nombre de traducteurs est relativement restreint – il est inférieur à cent en 1934 – et où presque tous se connaissent. Ces traducteurs, majoritairement canadiens-français, se côtoient dans les réunions mondaines et lors d’activités organisées par les sociétés littéraires, culturelles ou professionnelles. À une époque de grande religiosité, il y a parmi eux de fervents croyants, d’irréductibles athées et de farouches anticléricaux.

Si beaucoup d’entre eux entretiennent des relations amicales en dehors de leurs activités professionnelles, il y en a quelques-uns qui nourrissent de solides inimitiés. La chose est inévitable lorsque les personnalités fortes, les idées et les opinions politiques s’entrechoquent. Mais dans l’ensemble, on peut dire que ces artisans de la traduction forment une société de lettrés assez homogène et que la bonne entente règne parmi eux. On compte dans leurs rangs des avocats, des médecins, des bacheliers ès arts issus des collèges classiques et des journalistes, beaucoup de journalistes.
La présence féminine
En revanche, on note une faible proportion de femmes. Dans les années 1940, elles ne représentent encore que 14 % du personnel « traduisant ». Celles qui s’y engageront travailleront d’abord dans les ministères, où les services de traduction commencent à faire leur apparition à partir des années 1900. Il faut attendre, toutefois, la fin des années 1930 pour qu’une femme soit traductrice aux Débats.
Évelyne Bolduc (1888-1939) est la première. Fille du président du Sénat, l’honorable Joseph Bolduc, elle fait des études à l’Université Yale et, en 1915-1916, recueille des contes et des chansons folkloriques avec l’anthropologue Marius Barbeau. Au début des années 1930, elle entre aux Livres bleus et son contrat est renouvelé chaque année. Alors qu’elle est traductrice des Procès-verbaux du Sénat, de 1935 à 1937, elle est reçue à l’examen de recrutement du Bureau, mais on ne lui offre pas de poste. Elle accède finalement à la Division des débats en 1937, où elle reste jusqu’à son décès en 19393.
En 1943 arrive Rosette Renshaw (1920-1997), traductrice depuis un an au ministère des Services nationaux de guerre. Elle avait obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université McGill en 1942. Autres temps, autres mœurs, les épouses des traducteurs des Débats, qui, comme on le sait, travaillaient de nuit, voyaient d’un mauvais œil qu’une femme passe ses nuits en compagnie de leurs maris… Elles nourrissaient une secrète méfiance teintée de jalousie envers cette femme qui avait réussi à s’introduire dans ce château fort masculin4. Rosette Renshaw restera aux Débats jusqu’en juin 1951. Après son départ, elle poursuivra ses études et fera carrière en enseignement à l’Université d’État de New York, campus de New Pfalz.
La voie ayant été ouverte par ces deux pionnières, d’autres femmes marchèrent sur leurs traces et firent partie de l’équipe des Débats : 1949 : Gabrielle Saint-Denis; 1950 : Irène de Buisseret; 1952 : Irène Arnould et Marie-Blanche Fontaine.


Formation et innovations
En l’absence d’écoles de formation, c’est entre collègues que les recrues s’initient aux arcanes de la traduction administrative. Un petit nombre profite des cours du soir en traduction que Pierre Daviault (1899-1964) donne à l’Université d’Ottawa à partir de 1936.
En 1940, la Société des traducteurs de Montréal commence à offrir des cours du soir, elle aussi; deux ans plus tard, ces cours sont placés sous l’égide de l’Université McGill. Un Institut de traduction voit aussi le jour à Montréal en 1941 à l’initiative de Jeanne Grégoire et de Georges Panneton. L’Institut est intégré au service de l’éducation permanente de l’Université de Montréal dans les années 1960. Jusqu’en 1967, ce sont les seules formations en traduction offertes au pays. Elles attirent surtout des secrétaires soucieuses de parfaire leur connaissance de l’anglais et des employés de bureau à qui l’on confie des travaux de traduction dans les entreprises. Comme nous le verrons, les premiers traducteurs fédéraux venaient davantage des salles de presse que des salles de cours.
L’année 1967 marque une rupture, la fin d’une époque que d’aucuns seraient tentés de qualifier aussi d’« âge héroïque de la traduction », car, comme nous verrons, le feuilleton de la traduction au sein de l’administration fédérale est ponctué d’épisodes mouvementés et de gestes d’éclat qui ont fait les manchettes et soulevé les passions.
En cent ans, les seules innovations technologiques dont les traducteurs fédéraux ont profité sont la machine à écrire, commercialisée à partir de 1873 aux États-Unis5 – dans les premières années de la Confédération, on n’entendait pas le cliquetis des machines à écrire des traducteurs sur la Colline pour la simple raison que ces machines n’existaient pas encore – et la machine à dicter, importée de New York en 1953 par le surintendant Aldéric-Hermas Beaubien (1890-1985).
Une date charnière
L’histoire des traducteurs fédéraux comporte donc deux grandes périodes : avant et après 1967.
La traduction connaît, en effet, un essor spectaculaire après l’Exposition universelle de Montréal, caractérisée par une grande effervescence culturelle et une ouverture sans précédent sur le monde. Dès 1968, répondant à l’invitation du Secrétariat d’État qui crée un programme de bourses en traduction afin de favoriser le recrutement de traducteurs6, l’Université de Montréal met sur pied le premier programme universitaire de formation de traducteurs – une licence qui sanctionne trois années d’études.
Les programmes de formation se multiplient rapidement pour remédier à la pénurie de traducteurs qui sévit alors au pays. Les chiffres sont éloquents. Entre 1968 et 1984, un nouveau programme universitaire de traduction voit le jour tous les ans, un nouveau baccalauréat, tous les deux ans et une nouvelle maîtrise, tous les quatre ans. Le marché est porteur.
Dans le sillage de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, l’adoption, en 1969, de trois lois à caractère linguistique7 a eu des répercussions considérables sur l’évolution de la traduction, en général, et du Bureau des traductions, en particulier. D’ailleurs, ce Bureau a toujours constitué un excellent baromètre des progrès du bilinguisme officiel au Canada. En moins de dix ans, soit de 1964 à 1973, son budget explose littéralement, passant de deux à quinze millions de dollars, et son personnel fait un bond de 339 à 1118 fonctionnaires.
Une croissance tous azimuts
Cette croissance fulgurante s’accompagne de deux restructurations majeures du service – la première a lieu en 1967 –, d’une reclassification des traducteurs et de l’adoption, en 1968, d’un règlement d’application de la Loi concernant le Bureau des traductions. Plus que jamais, la traduction est vue dans les officines du pouvoir comme une réalité indissociable de la vie politique canadienne et des grandes orientations en matière de bilinguisme officiel.
On envisage même la création d’un ministère de la Traduction8. Si l’idée, lancée en 1965 à la Chambre des communes par le député de Trois-Rivières Léon Balcer, séduit le premier ministre Lester B. Pearson, elle reste sans lendemain.
Les années subséquentes voient se développer la terminologie à la faveur de la francisation des entreprises au Québec9 et de la décision du Cabinet du 7 novembre 1974, décision qui élargit le mandat du Bureau en l’investissant d’un droit de regard sur la qualité et l’évolution de la langue administrative et sur sa normalisation. Elles voient aussi se multiplier les revues et les ouvrages spécialisés en traduction, se succéder à un rythme effréné les colloques sur la traduction et la terminologie, germer l’idée de recourir à la traduction automatique pour accélérer la production10, naître les outils de la bureautique, les banques de terminologie et la traductique et se ramifier la Toile aux ressources incomparables.
Parallèlement, à partir de 1967, on assiste au relèvement substantiel du traitement des traducteurs fédéraux et à l’intensification des démarches en vue d’obtenir des législateurs provinciaux la reconnaissance professionnelle, démarches qui aboutiront à l’obtention du titre réservé dans trois provinces. La profession se féminise également, tendance qui s’accentue dans les années 1980 et 1990.
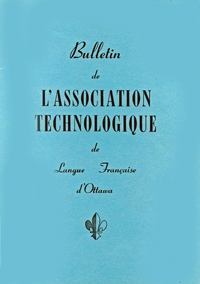
Hormis la création de cours du soir en traduction et de deux organes de traduction11, tous les changements énumérés ci-dessus sont postérieurs à 1967. Le contexte dans lequel s’exerce le métier de traducteur après cette date charnière est radicalement différent de ce qu’il a été au cours des cent années antérieures.
Notre première incursion chez les traducteurs fédéraux nous révélera quelques-uns des privilèges auxquels ils avaient droit et sera pimentée de quelques anecdotes savoureuses. Sans plus de préambule, immergeons-nous donc dans l’esprit de cette époque qui dégage le charme des vieilles photos jaunies ou d’anciennes cartes postales.
Les privilèges
Entré au service de l’administration fédérale en 1911 et promu traducteur en 1922, Hector Carbonneau se souvient que le personnel de la Division des débats et de la Division des lois, les deux plus prestigieuses du service, jouissait d’une grande liberté, sans doute en raison des liens de proximité qui les rattachaient aux députés, aux ministres et aux sénateurs qu’ils côtoyaient sur la Colline et dont ils traduisaient les propos quotidiennement.
Ce personnel « avait libre accès à tous les avantages offerts aux parlementaires : bibliothèque du Parlement, salle de lecture, tribune spéciale [à la Chambre des communes], sans compter la tant regrettée taverne de la Chambre réduite en cendres lors de l’incendie du Palais du Parlement le 3 février 191612 ». Comme le monde était en guerre, on y a vu l’œuvre d’une main criminelle allemande, mais ces soupçons n’ont jamais pu être corroborés13. La taverne, dont parle Hector Carbonneau, était située au sous-sol. On la désignait de divers noms : salle des rafraîchissements, salle du bar, bar, buvette et tabagie.
La liste des privilèges accordés aux traducteurs avant la centralisation ne s’arrête pas là. Laissons Rodolphe Girard (1879-1956) en énumérer quelques autres :
À chaque session, les sénateurs, les députés, les correspondants parlementaires et les traducteurs des deux Chambres recevaient de grosses mallettes bourrées de papeterie de luxe et de divers articles de choix, tels que sacoches, nécessaires à ouvrage et de toilette, canifs, stylos, porte-monnaie et le reste. […] En outre, le service de la papeterie et d’articles de bureau, amplement pourvu […], était à notre disposition. Avec la simple signature du greffier de la Chambre, nous pouvions nous munir d’objets dont nous eussions facilement pu nous passer. […] J’ai devant les yeux, sur ma table de travail un superbe classeur en chêne, que j’ai obtenu de ce service de l’État. Nous jouissions du privilège de la franchise postale, même pour les lettres recommandées14.
Par les lettres personnelles qu’ils s’échangent sur le papier à en-tête de la Chambre des communes, des traducteurs de l’époque, dont Toussaint Gédéon Coursolles, Achille Fréchette, Louis Laframboise et Hector Carbonneau, nous fournissent la preuve tangible de ce que Rodolphe Girard qualifie, avec le recul, de « générosité mal inspirée de l’administration15 ».

Certains traducteurs, semble-t-il, usaient de leur liberté de manière plutôt insolite. Musicien à ses heures, le chef de la Division des lois, l’avocat Oscar Paradis (1874-1937), avait pris l’habitude d’arriver au bureau à 7 h du matin et de se mettre aussitôt au travail. Vers 11 h, il posait son crayon, sortait son violoncelle d’une grande armoire et se mettait à promener son archet sur son instrument dont il tirait des interprétations de Bach, Boccherini ou Brahms16. L’histoire ne dit pas, toutefois, si ses collègues appréciaient ce récital quotidien. On peut le penser, car les traducteurs sont en général de fins mélomanes, eux qui sont particulièrement sensibles à l’euphonie et au rythme des phrases.
Des squatteurs sur la Colline
Pendant la crise des années 1930, deux traducteurs de Montréal voulurent, par souci d’économie, éviter de louer une chambre à Ottawa. À l’époque, les traducteurs, surtout ceux des services parlementaires, ne résidaient pas tous dans la Capitale. Certains n’y venaient que pour la durée des sessions. Nos deux fins renards, Charles Édouard Duckett (1886-1964) et Eduard Maubach (1894-1955), réussirent à introduire un canapé dans un grand local à débarras de l’édifice de l’Ouest, et c’est sur ce lit de fortune – eux qui n’en avaient pas – que nos deux compères passaient leurs nuits.
Leur stratagème fonctionna à merveille jusqu’au jour où l’un d’eux s’étant levé un soir pour aller là où même un roi ne peut envoyer son valet se retrouva face à face avec les femmes de ménage qui, saisies de panique, s’empressèrent de dénoncer les intrus17. On ignore ce qu’il advint du canapé.
Quant aux deux squatteurs, leur système D n’ayant pas le caractère d’une honteuse prévarication, on ne leur en tint pas rigueur et ils conservèrent leur poste. Duckett sera plus tard promu chef du service de traduction du Conseil privé et Maubach restera, jusqu’à la fin de la guerre, le seul traducteur de la Division des langues étrangères, où il finira d’ailleurs sa carrière.
Du tac au tac
Les traducteurs ont cette réputation, nullement surfaite, d’être de fins lettrés et des gens d’esprit qui savent jongler avec les mots dont ils connaissent les moindres subtilités. Quotidiennement, ils en soupèsent les nuances et les effets avec « un jeu d’invisibles, d’intellectuelles balances aux plateaux d’argent18 ».


Rodolphe Girard eut un jour une prise de bec avec Pierre Daviault qui lui dit : « Mon cher confrère, vous commettez un anglicisme. » L’auteur de Marie Calumet lui répond : « Sachez, savant collègue, que je sais mon français. »—« Votre français? Évidemment. Mais c’est le français, qu’il faut connaître19. »
Je terminerai cette première chronique par une autre réplique savoureuse. Un jour, le même Pierre Daviault fit venir à son bureau Ernest Plante (1912-1993) et lui dit : « Le dictionnaire donne comme “rare” le mot que vous avez employé dans votre traduction. » Et le traducteur de lui répondre du tac au tac : « Je le sais; il est rare aussi que je l’emploie20. »
Le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne manquaient pas d’esprit de répartie, ces traducteurs!
Je remercie Alain Otis, enseignant à l’Université de Moncton, pour ses commentaires et compléments d’information.
Source des illustrations
Fig. 1 Centre d’études acadiennes, Fonds Hector-Carbonneau, P34-A3
Fig. 2 Centre de recherche en civilisation canadienne-française, CRCCF, Ph129-120, détail
Fig. 3 CRCCFCRCCF, Ph129-121, détail
Fig. 4 Collection personnelle de J. Delisle
Fig. 5 La Presse, 5 avril 1924, détail
Fig. 6 Photo du domaine public
Fig. 7 CRCCF, Ph129-120, détail
Notes et références
- 1 Service qu’on appelait jusque vers la fin des années 1920 les « Livres bleus ». On y traduisait tous les textes parlementaires, à l’exception des Débats.
- 2 Hector Carbonneau, « Souvenirs d’un traducteur et lexicographe », Cultures du Canada français, no 4, 1987, p. 80.
- 3 Lettre d’Alain Otis (23 octobre 2012) à Jean Delisle (Gatineau).
- 4 Information recueillie en 1983 auprès de la veuve du surintendant Henriot Mayer (1908-1982).
- 5 La première machine électrique fit son apparition en 1914 et la première machine à écrire portable en 1935.
- 6 À la suite de la décision du Cabinet du 25 octobre 1967.
- 7 La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, adoptée par l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, la Loi sur les langues officielles, adoptée par le Parlement canadien, et la Loi pour promouvoir la langue française au Québec (Loi 63), adoptée par l’Assemblée nationale du Québec.
- 8 Débats de la Chambre des communes, 17 mars 1965, p. 12668.
- 9 La terminologie acquiert même le statut de nouvelle profession, reconnue par le législateur québécois. Voir Jean Delisle, La terminologie au Canada. Histoire d’une profession, Linguatech, 2008.
- 10 Débats de la Chambre des communes, 5 novembre 1964, p. 10008; 2 avril 1965, p. 13365-13366.
- 11 Le Bulletin de l’Association technologique de langue française d’Ottawa (1951-1957) et le Journal des traducteurs (1955-1965), précurseur de la revue Meta.
- 12 Hector Carbonneau, op. cit., p. 80.
- 13 « Il y a le feu sur la Colline! », L’Encyclopédie canadienne, http://www.thecanadianencyclopedia.com/featured/fr/il-y-a-le-feu-sur-la-colline.
- 14 « À Ottawa, il se fait des dépenses folles en cadeaux inutiles », Le Petit Journal, 13 novembre 1949, Supplément, p. 15.
- 15 Ibid.
- 16 Anecdote recueillie par l’auteur auprès de Wilfrid Michaud, 1983.
- 17 Anecdote recueillie par l’auteur auprès de Frédéric Phaneuf, 1983.
- 18 Valery Larbaud, Sous l’invocation de saint Jérôme, Gallimard, 1942, p. 82.
- 19 Charles Michaud, « Matière et forme », Mémoire de la Société royale du Canada, section I, 1945, p. 136. Texte remanié d’une causerie donnée à l’ATLFO le 17 décembre 1943.
- 20 Anecdote recueillie par l’auteur auprès de Frédéric Phaneuf, 1983.
© Public Services and Procurement Canada, 2025
TERMIUM Plus®, the Government of Canada's terminology and linguistic data bank
Writing tools – Chroniques de langue
A product of the Translation Bureau


